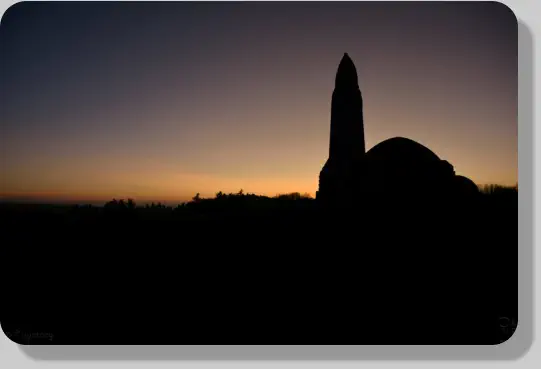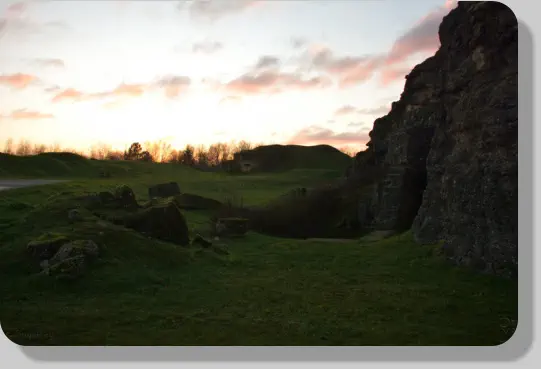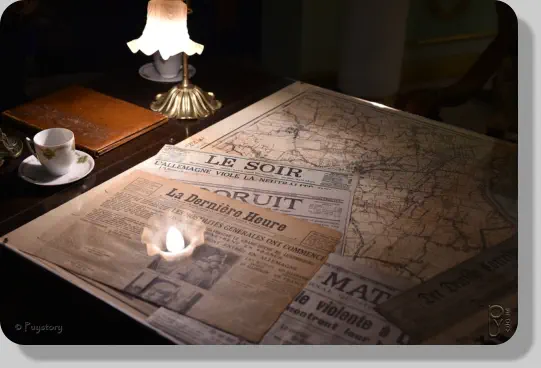Entre 1871 et 1914, l'Europe profite d'une paix relative.
La
rivalité
franco-allemande,
plus
vivace
que
jamais,
se
détourne
de
la
"ligne Bleu Des Vosges" et s'exprime hors du continent européen.
Marquée
par
son
humiliante
défaite
dans
la
guerre
de
1870,
la
France
fait
de son empire colonial un exutoire à ses frustrations.
L'Allemagne
de
l'empereur
Guillaume
II,
jusqu'alors
hermétique
aux
questions
extra-européennes,
s'engage
dans
une
politique
expansionniste
agressive et regarde les possessions coloniales des autres puissances.
Le
début
du
20ème
siècle
est
le
temps
des
alliances
complexes
et
d'une
course
aux
armements
qui
vont
déboucher
sur
le
conflit
le
plus
meurtrier
de l'histoire.
Depuis
1904,
l'Entente
cordiale
est
établie
entre
la
France
et
la
Grande-
Bretagne, rejointes en 1907 par la Russie au sein de la Triple-Entente.
Elle
répond
à
la
Triple-Alliance
ou
"Triplice",
signée
entre
l'Allemagne,
l'Autriche-Hongrie et l'Italie en 1882.
L'équilibre de l'Europe est fragile.
En
1911,
l'envoi
d'une
canonnière
allemande
dans
la
baie
d'Agadir,
au
Maroc, manque de peu de déclencher une guerre.
Dans
les
Balkans,
la
fragmentation
territoriale
imposée
par
les
puissances
lors du congrès de Berlin de 1878 a créé une situation explosive.
Les
guerres
balkaniques
de
1912
et
1913
sont
les
prémices
du
conflit
mondial.
Le
28
juin
1914,
l'assassinat
de
l'archiduc
François-Ferdinand
à
Sarajevo,
en Bosnie, déclenche l'embrasement général.
Le 28 juillet, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie.
Le
lendemain,
la
Russie,
alliée
historique
des
Serbes,
ordonne
la
mobilisation.
L'événement déclenche une réaction en chaîne.
Le 3 août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la France.
Le lendemain, le Royaume-Uni entre à son tour en guerre...
On prévoit un conflit bref mais violent.
Pour
la
France,
une
chose
importe
est
de
récupérer
l'Alsace
et
la
Lorraine,
perdues en 1871.
Le
5
août
1914,
suivant
le
"plan
Schlieffen",
l'armée
allemande,
commandée
par von Moltke, pénètre en Belgique neutre.
Joffre,
général
en
chef
des
forces
françaises,
applique
aveuglément
le
"plan
XVII" et concentre ses efforts sur l'Alsace et la Lorraine.
Le 23 août 1914, les Allemands percent les Ardennes et menacent Paris.
10000
soldats
sont
envoyés
sur
le
front
de
la
Marne
(grâce
aux
taxis
parisiens)
et
réussissent
du
6
au
12
septembre1914
à
enrayer
l'avancée
allemande.
Un nouvel enjeu se dessine.
Les
ports
de
la
Manche
et
de
la
mer
du
Nord,
voies
de
communication
entre
France et Grande-Bretagne.
La
bataille
d'Ypres,
du
29
octobre
au
24
novembre
1914,
victoire
décisive
alliée, est le dernier épisode de cette "course à la mer".
À l'approche de l'hiver, le front se stabilise.
De part et d'autre, on creuse des tranchées.
En
1915,
Joffre
lance
des
offensives
en
Champagne,
en
Artois
et
sur
la
Woëvre.
Des
opérations
secondaires
sont
conduites
en
Flandres,
en
Argonne,
dans
les Vosges.
La
deuxième
bataille
d'Ypres
crée
un
effroyable
précédent
dans
l'histoire
militaire.
Le
22
avril
1915,
les
Allemands
lâchent
dans
l'atmosphère
150
tonnes
de
gaz
asphyxiant (gaz moutarde), faisant 5200 morts.
À
Verdun,
dans
la
Meuse,
saillant
dans
la
ligne
de
front,
le
général
Falkenhayn veut "saigner à blanc l'armée française".
De
février
à
décembre
1916,
163000
Français
et
143000
Allemands
vont
mourir dans les tranchées.
Les lignes sont disloquées par le déchaînement de l'artillerie.
Les
positions
perdues
un
jour
sont
reprises
le
jour
suivant
dans
un
va-et-
vient incessant.
La France ne veut à aucun prix abandonner ce haut lieu de son histoire.
C'est
à
Verdun
en
843
qu'a
été
scellé
le
partage
de
l'Empire
carolingien
donnant naissance à la France.
C'est
là
aussi
que
Charlemagne
a
partagé
son
Empire,
et
les
forts
qui
protègent
la
ville
dont
celui
de
Douaumont,
est
un
sujet
de
fierté
nationale
en France.
Pour l'Allemagne, une victoire à Verdun devient impérative.
Le
général
Falkenhayn
en
charge
des
opérations
sur
le
front
de
l'Ouest
a
toute
la
confiance
du
Kaiser
Guillaume
II
pour
mener
à
bien
cette
offensive,
que l'on espère décisive.
Fin décembre, Falkenhayn a fixé son choix.
Ce sera Verdun.
Près
d'un
siècle
plus
tard,
ses
intentions
exactes
demeurent
mystérieuses
car
le
mémorandum
de
Noël
1915,
dans
lequel
le
général
allemand
se
serait
fixé
comme
objectif
celui
de
"saigner
à
blanc
l'armée
française",
est
probablement une invention de l'après-guerre.
Mais
si
l'on
admet
que
son
intention
était
celle-là,
le
secteur
de
Verdun
semble l'endroit idéal pour mener une bataille d'usure.
Depuis
1914,
la
région
fortifiée
de
Verdun
(RFV)
forme
un
saillant
sur
la
rive
droite
de
la
Meuse,
que
l'on
peut
donc
attaquer
depuis
plusieurs
directions.
Il
est
par
ailleurs
très
mal
desservi
côté
français,
puisqu'une
seule
ligne
de
chemin de fer, étroite.
Reliant
Bar-le-Duc
à
Verdun,
peut
permettre
d'y
acheminer
rapidement
des
renforts et du matériel.
Falkenhayn
a
prévu
une
attaque
sur
un
front
de
7
km,
sur
la
rive
droite
de
la Meuse.
Six
divisions
d'infanterie,
soutenues
par
un
millier
de
pièces
de
tous
calibres,
dont
des
obusiers
de
420
mm,
doivent
s'emparer
dans
les
meilleurs
délais
du
terrain
qui
les
sépare
de
la
ville
de
Verdun,
soit
une
petite quinzaine de kilomètres.
Face
à
eux,
deux
divisions
françaises,
déployées
dans
des
tranchées
peu
profondes et manquant souvent de barbelé.
Le
21
février,
l'attaque
commence
par
un
bombardement
d'une
violence
telle qu'il est audible à plus de 200 km.
Après
un
pilonnage
de
près
de
huit
heures
et
vers
17
heures,
l'infanterie
allemande sort de ses abris.
On
a
affirmé
aux
soldats
allemands
qu'ils
ne
rencontreraient
aucune
résistance.
Mais
rapidement,
dans
les
cratères
et
le
sol
ravagé
par
les
obus,
des
soldats
français se dressent et livrent bataille avec l'énergie du désespoir.
Ils ne peuvent que retarder la marche.
En trois jours, la progression allemande est spectaculaire de près de 5 km.
Le
fort
de
Douaumont,
défendu
par
une
compagnie
de
territoriaux,
tombe
sans combattre le 24 février 1916.
La
ville
de
Verdun
est
à
présent
menacée
et,
côté
français,
il
convient
de
réagir vite.
Le
25
février,
Joffre
décide
de
nommer
le
général
Pétain,
un
défensif,
à
la
tête du secteur.
Ne
comprenant
pas
pourquoi
les
Allemands
n'ont
pas
attaqué
sur
la
rive
gauche,
il
y
déploie
toutes
les
batteries
d'artillerie
qu'on
veut
bien
lui
allouer
pour
prendre
les
Allemands
en
enfilade
et
parvient,
en
quelques
jours, à endiguer leur avance.
Sa
tâche
est
facilitée,
puisque
l'infanterie
allemande
a
progressé
si
vite
que
son artillerie lourde est à présent hors de portée pour la soutenir.
Le
Kronprinz,
fils
du
Kaiser,
chargé
du
secteur,
demande
et
obtient
que
le
front s'étende à la rive gauche de la Meuse.
C'est
chose
faite
le
6
mars,
et
les
Allemands
remportent
des
succès
notables
se rapprochant des éminences du Mort-Homme et de la cote 304.
De
nouveaux
renforts
expédiés
côté
français
permettent
de
rétablir
la
situation.
Le
1er
mai
1916,
le
général
Pétain
est
placé
à
la
tête
du
groupe
d'armées
Centre, en charge du secteur de Verdun.
C'est
là
que
le
général
va
pouvoir
superviser
le
va-et-vient
de
camions
chargés
de
matériel
et
d'hommes
en
direction
du
front
de
Verdun,
empruntant
cette
route
élargie
par
le
génie,
et
entrée
dans
l'histoire
sous
le
nom de Voie sacrée.
Les
prouesses
logistiques
des
Français
vont
avoir
un
impact
décisif
sur
le
cours des opérations.
Sur le front de Verdun, le général Mangin, un offensif, a remplacé Pétain.
Dès le 2 mai, il tente de reprendre Douaumont.
Mal préparée, cette attaque échoue, avec des pertes sévères.
Les Allemands reprennent alors l'offensive et s'emparent du Mort-Homme.
Le
1er
juin,
c'est
le
fort
de
Vaux
qui
tombe
et
à
la
fin
du
mois,
de
nouvelles
troupes allemandes tentent d'emporter la décision sur la rive gauche.
Les pertes sont sévères de part et d'autre.
Le front se stabilise.
Le
1er
juillet,
l'armée
alliée
attaque
sur
la
Somme
pour
soulager
les
troupes
françaises de la Meuse.
Appuyée
par
une
intense
préparation
d'artillerie,
l'infanterie
progresse
lentement.
Mais
l'offensive
par
laquelle
Joffre
espérait
revenir
à
une
guerre
de
mouvement s'enlise.
Fin
août,
Falkenhayn
est
limogé
et
son
remplaçant,
Hindenburg,
décide
d'opter pour la défensive.
Mais
les
Français
préparent
leur
contre-offensive
grâce,
notamment,
à
de
nombreuses troupes coloniales.
Le 24 octobre, Douaumont est repris, puis Vaux.
Jusqu'au 18 novembre, 206000 Britanniques et 66000 Français périssent.
C'est l'opération la plus meurtrière de la guerre.
L'objectif est néanmoins atteint.
Les Allemands lâchent prise à Verdun.
Le
15
décembre,
une
dernière
poussée
française,
massive,
permet
de
rétablir
la
situation
et
ramène
presque
les
Allemands
sur
leurs
lignes
de
départ.
La bataille de Verdun est terminée.
La
bataille
de
Verdun
demeure
un
symbole,
celui
de
la
guerre
des
tranchées, brutale, abominable, impersonnelle.
De
très
nombreux
soldats
français
et
allemands
sont
morts
sans
avoir
jamais vu l'ennemi, écrasé par les obus.
La
bataille
de
Verdun
est
en
effet,
et
avant
tout,
une
gigantesque
bataille
d'artillerie.
Les
deux
premiers
jours
de
l'offensive,
deux
millions
d'obus
sont
tombés
sur les positions françaises.
Au total, les Allemands perdent 300000 hommes, tués, blessés et disparus.
Les Français, 375000.
Une véritable boucherie, pour un résultat territorial nul.
L'armée
française
est
confrontée
en
1917
à
une
vague
de
mutineries
sans
précédent.
Le
souvenir
de
la
boucherie
de
Verdun
et
l'échec
de
l'offensive
du
Chemin
des
Dames
ont
sérieusement
ébranlé
le
moral
des
soldats
français,
qui
multiplient les actes de colère et d'indiscipline.
L'arrivée
au
pouvoir
des
bolcheviks
en
Russie
par
la
révolution
de
février
1917 effraie les généraux alliés, qui redoutent une contagion.
La répression est confiée au général Pétain.
En
mai
et
en
juin
1917,
le
conseil
de
guerre
prononce
des
peines
exemplaires à l'encontre de 3500 soldats, dont 600 sont condamnés à mort.