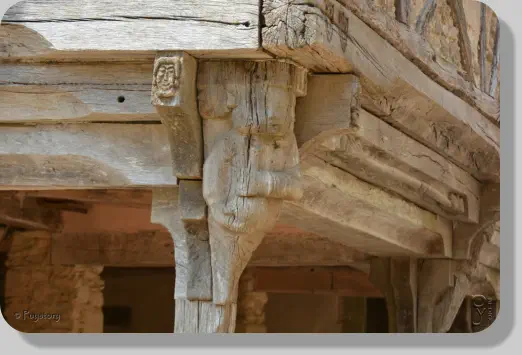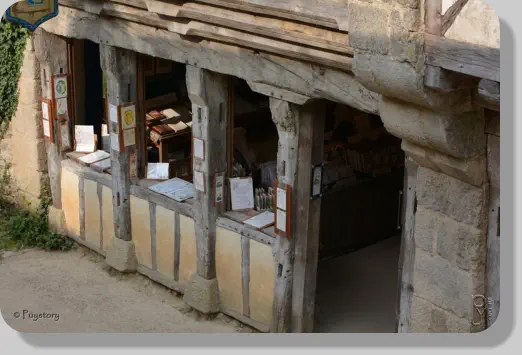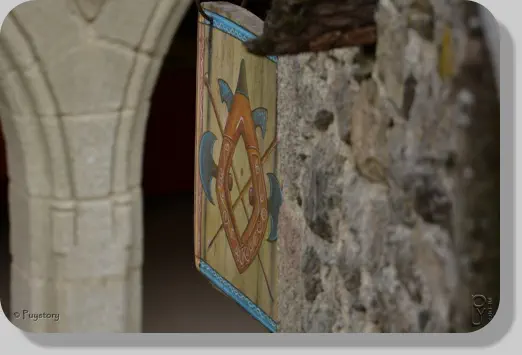La Cité Médiévale du Puy du Fou est l'exacte reconstitution d'une ville fortifiée du XVème siècle.
Nous seront très surpris de découvrir le piètre état du système défensif.
En
cette
période
de
paix
relative
et
de
reprise
économique
qui
succède
à
la
guerre
de
Cent
Ans
(1337-1453), la menace d'éventuels conflits semble s'éloigner et les murailles sont négligées.
Au
nord
et
au
sud
de
la
Cité
s'élèvent
deux
châtelets
d'entrée
équipés
d'un
hourd
de
surveillance,
dont l'un est percé d'archères (châtelet nord, près de l'atelier du tailleur de pierre).
Des huchettes masquent les ouvertures des hourds du châtelet sud (face à la chapelle).
Les
tours
reposent
sur
une
base
inclinée,
le
talus,
qui
dissuade
les
échelades
et
favorise
le
rebond
sur
l'ennemi
des
projectiles
lancés
depuis
les
mâchicoulis,
nettement
visibles
au
sommet
de
l'édifice sud, sous les créneaux.
La
porte
nord
est
équipée
d'une
herse,
dont
le
système
à
rouleau
est
visible
dans
la
chambre
de
herse.
On
accède
à
la
porte
sud
par
un
pont
dormant
courbe,
destiné
à
ralentir
la
progression
des
assaillants.
Un pont-levis à flèches permet une fermeture rapide de l'accès.
Les tours des châtelets sont percées de meurtrières dont les formes ont varié au cours des siècles.
Longues
et
étroites
archères
(muraille
et
châtelet
nord)
ou
rondes
canonnières
(châtelet
sud)
apparues au XIVème siècle avec l'invention des armes à feu.
La
tour
située
à
droite
du
pont-levis
est
percée
d'une
baie
en
verre
dont
l'usage
était
encore
rare
et
coûteux au XVème siècle.
Il
s'agit
là
du
signe
de
l'abandon
progressif
des
fonctions
défensives
du
château
au
profit
d'un
usage d'habitation.
La
courtine
a
subi
plus
qu'une
simple
démilitarisation,
un
encorbellement
de
maison
à
pans-de-
bois,
prenant
directement
appui
sur
la
muraille,
forme
une
surprenante
excroissance,
nouvelle
manifestation de l'empiètement progressif de l'espace civil sur l'espace militaire.
Des douves entourent la forteresse mais ne protègent plus la Cité.
Une poterne à deux vantaux donne accès à un lavoir.
Sur
les
parois
des
tours
et
de
la
courtine
apparaissent
des
orifices
carrés,
les
trous
de
boulins,
dans
lesquels étaient fixés les échafaudages lors de l'édification de la place forte.





Au Moyen Age, les villes médiévales sont construites sans ordre et sans plans.
Elle est très animée, autour d'une église ou autour d'une place, d'un château, où les habitants se réunissent.
Ce sont des rues étroites et très sombres, sans trottoirs, boueuses, avec des animaux en liberté.
Certaines rues sont pavées.
Il n'y a pas l'eau courante, il faut se la faire livrer.
On s'éclaire à la lanterne et à la bougie.
Dans les rues, il n'y a pas d'éclairage.
Les
maisons
bourgeoises
sont
peu
à
peu
construites
en
pierre,
suite
à
l'évolution
des
engins
de
construction
et de levage.
Seules les demeures de nobles et de bourgeois possèdent une cuisine et une cheminée.
Au Moyen Âge, la maison de ville comporte en général deux niveaux.
C'est au premier étage que l'on habite, le rez-de-chaussée étant réservé à des boutiques.
Les
maisons
ordinaires,
aux
murs
à
colombages,
sont
assez
étroites,
avec
une
ou
deux
fenêtres
par
étages,
serrées les unes contre les autres.
Constituées
d'un
rez-de-chaussée
de
pierre
et
de
trois
ou
quatre
étages
de
bois
et
de
torchis,
elles
sont
desservies par un escalier à vis.
La couverture du toit est faite de chaume ou de lattes de bois.
Comme
il
y
a
de
gros
risques
d'incendies,
d'autant
plus
que
les
maisons
sont
en
partie
en
bois,
les
habitants
doivent éteindre les lumières lorsque sonne le couvre-feu.
L'espace
commercial
(rez-de-chaussée)
et
l'espace
d'habitation
peuvent
avoir
des
locataires
ou
propriétaires
différents.
Les
habitations
subissent
donc
les
nuisances
(bruits,
odeurs,
poussières,
pollutions...)
engendrées
par
les
boutiques du rez-de-chaussée.
Les magasins sont ouverts sur la rue, mais faute de place, les artisans exposent leurs produits sur la chaussée.
Les jours de marché, les rues s'emplissent de colporteurs, artisans itinérants.
Les
vendeurs
en
profitent
pour
vendre
des
produits
venus
de
pays
lointains,
ou
qu'ils
ont
acheté
dans
les
foires,
les propriétaires des campagnes viennent y vendre des céréales, du vin, des légumes, etc...
Dans
la
rue,
on
trouve
quantité
de
petits
traiteurs
ou
marchands
ambulants
qui
proposent
aux
passants
poêlons de tripes, pâtés de viandes, écrevisses, tortues, saucisses, gaufres ou petits gâteaux.
Car à l'époque, tout le monde ne dispose pas d'une cuisine.
Les foyers les plus modestes n'en sont pas équipés.
Les tavernes y sont très nombreuses et très fréquentées.
Les villes médiévales, attirent aussi de nombreux brigands, des mendiants, des vagabonds, des pauvres.
Il n'y avait aucune police.
Et
de
nuit,
la
rue
devient
le
royaume
des
professionnels du crime.
Dans
les
murs
de
l'habitation
médiévale,
on
trouve
des
petites
niches,
elles
sont
destinées
aux
rangements
ou
à poser des lampes à huile ou des chandelles.
On trouve également différents meubles destinés au rangement : caisses, coffres, dressoirs et armoires.
A partir du XIIIe siècle, les maisons des villes connaissent des progrès en matière d'hygiène et de chauffage.
Ainsi, des éviers, des latrines et des cheminées se retrouvent dans ces bâtiments.
La
cheminée
se
compose
d'un
foyer,
d'une
hotte, et d'un conduit vers l'extérieur.
Elle se trouve rarement dans les édifices antérieurs au XIIIe siècle.
Auparavant, le foyer se trouve dans la cour.
Il intègre ensuite la maison sous la forme d'un feu ouvert au centre de l'habitation avec un trou d'aération.
Pour
limiter
la
perte
de
chaleur,
dans
les
demeures
riches,
on
place
sur
les
murs
des
tentures
qui
retombent
jusqu'au sol.
Jusqu'au XIVe siècle, les fenêtres des maisons n'ont pas de vitres.
Lorsqu'on
en
rencontre
par
la
suite,
elles
se
trouvent
dans
de
riches
demeures
qui
peuvent
seules
se
le
permettre.
Ainsi,
les
ouvertures
sont
rares
car
il
faut
utiliser
des
toiles,
des
parchemins
huilés
ou
des
volets
pour
les
fermer.










Au
milieu
du
XIIIème
siècle,
en
raison
de
l'accroissement
de
la
population,
de
la
raréfaction
de
l'espace
disponible et des contraintes liées au parcellaire urbain, les encorbellements se multiplièrent.
Qu'ils
soient
sur
solives
(maison
du
portraitiste),
sur
entretoises
(maison
du
calligraphe),
sur
piliers
(petite
taverne près de la chapelle), ou une pièce qui prend appui sur la partie extérieure de l'enceinte fortifiée.
Les
maisons
à
pans-de-bois
de
la
Cité
Médiévale,
offrent
le
spectacle
pittoresque
de
leurs
hourdis
en
torchis,
en
moellons
ou
en
tuileau
et
de
leur
charpenterie
complexe
(décharges
en
diagonale,
en
croix
de
Saint-
André, en chevrons...) qui ne permet pas toujours d'éviter le déversement de certaines façades sur la rue.
Nous apercevrons que le dernier étage de la demeure du portraitiste penche de façon inquiétante !
Les maîtres imagiers sculptaient... poteaux corniers, consoles et sablières des plus riches habitations.
L'Estaminet offre au visiteur le spectacle de son étonnant décor.
La
console
de
gauche
est
ornée
d'un
personnage
souriant,
coiffé
de
pampres
et
portant
une
bouteille
tandis
que celle de droite arbore un buste féminin.
L'entretoise inférieure sort de la gueule de deux engoulants en forme de renards.
Elle
est
surmontée
d'énigmatiques
cartouches
portant
les
emblèmes
et
les
initiales
des
artisans
qui
ont
participé à l'édification de la maison.
Les échoppes occupaient généralement le rez-de-chaussée des édifices.
Les artisans travaillaient dans leurs ouvroirs qui donnaient directement sur la rue.
Les marchandises étaient exposées sur des étals, comme dans l'atelier du talmelier.
De
nombreuses
enseignes
signalaient
aux
chalands
la
spécialité
de
l'artisan
(tonnelier,
calligraphe,
aubergiste, sculpteur sur bois...).
Elles rappelleront l'importance de l'image dans une société médiévale largement analphabète.